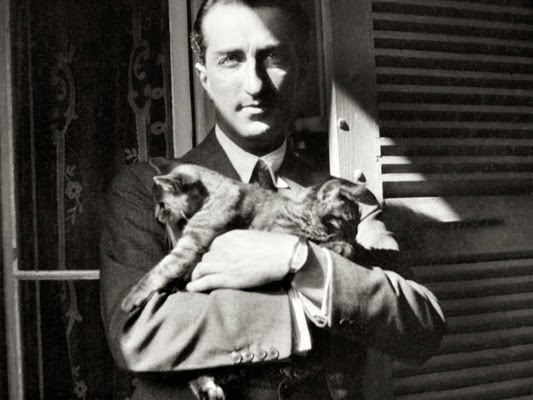LE REGARD DE LOUIS DELLUC
Par Jacques Richard
Par Jacques Richard
Jusqu’en 1914, la
production cinématographique en France s’adresse d’abord à un public avide
d’émotions élémentaires, celles-là même que peuvent lui procurer dans le même temps
les théâtres de quartier où l’on joue le mélodrame et le vaudeville polisson.
Les spectateurs entrent dans les salles obscures pour passer un bon moment et
sans toujours savoir ce qu’ils vont voir. Leurs journaux habituels ne leur
proposent que des annonces flatteuses rédigées d’une encre quasi publicitaire
par des chroniqueurs généralement stipendiés par les maisons de production.
Point de critiques dignes de ce nom, analysant librement le bon comme le moins
bon et justifiant leurs conseils. Les cinémas attirent le bon peuple et
apparemment cela suffit.
Louis
Delluc ne mange pas de ce pain là. Venu de son Périgord natal, il est arrivé à
Paris en 1903, à l’âge de treize ans. Il voulait tellement devenir écrivain que
ses parents, pharmaciens aisés, se sont installés avec lui dans la capitale pour
l’aider à prendre son essor. Encore lycéen, l’adolescent Louis Delluc, féru de
théâtre, écrit des pièces, des poèmes, et déjà des articles dans Comoedia illustré. Il se lie avec des
acteurs et plus étroitement avec la créatrice du rôle de Sygne dans L’Otage de Paul Claudel, Eve Francis
qu’il finira par épouser. Réformé, Louis Delluc échappe à la mobilisation de
1914. Il continue d’aller au spectacle mais le cinéma du tout venant ne
l’intéresse pas. La révélation viendra en 1915 quand Louis Delluc découvrira
Sessue Hayakawa dans le film de Cecil B. DeMille Forfaiture. Choc inattendu.
« Ah,
que j’ai détesté le cinéma ! Avant la guerre, je n’y allais jamais, sinon
contraint et forcé, avouera Louis Delluc. Il fallut Forfaiture pour tout démolir. Je m’aperçus à la fois de la beauté
insoupçonnée de cet art et de l’incompréhension vigoureuse du public (…)
Presque personne ne pensa de fait à la nouveauté absolue du cinéma, art
complexe, subtil, rare, puissant et rebutant (…) Le cinéma est une
merveille. » Par delà les défauts de ce film, qui ne lui échappent pas,
Louis Delluc devine tout ce que peut devenir l’art nouveau. Il va se vouer à sa
célébration. Il sera un vrai critique de cinéma, le premier sans doute.
Colette
elle aussi, dans L’Excelsior, parle
parfois des films qu’elle découvre et le musicologue Émile Vuillermoz a donné
dès la fin de 1916 quelques critiques de cinéma au quotidien Le Temps, Mais Delluc officie
régulièrement. Il entre en scène dans l’hebdomadaire Le Film le 25 juin 1917 en analysant très longuement un film de
Miller et Thomas Ince, Illusion.
Encore une production américaine. Louis Delluc n’a pas fini de célébrer le
cinéma d’outre-Atlantique pour la fraîcheur et la vérité que lui confèrent des hommes
comme Ince, DeMille, Chaplin, Fairbanks. À partir de mai 1918 il collabore à Paris Midi où sa verve ravageuse se
donne libre cours, aux dépens de quelques valeurs françaises consacrées pour
leur prestige au théâtre, telle Gabrielle Robinne. On commence à craindre
Delluc dont l’ironie cinglante fait des ravages. Le 14 janvier 1920 commence à
paraître Le Journal du Ciné-Club dont
Louis Delluc est le rédacteur en chef et où il s’exprime largement.
L’hebdomadaire Cinéa lui succèdera en
mai 1921 et durera un peu plus d’un an. C’est là qu’il invente le mot
‘‘cinéaste’’, rejetant ‘‘écraniste’’ que propose le théoricien du cinéma
Ricciotto Canudo à qui l’on doit en revanche l’expression ‘‘septième art’’. Delluc
exercera par la suite son talent dans le quotidien Bonsoir.
Il a trouvé le
temps d’écrire plusieurs livres consacrés naturellement au cinéma, au regard
très personnel qu’il porte sur ce qu’il tient à considérer comme un art : Cinéma et Cie en 1919, Photogénie, Charlot, La Jungle du cinéma,
où sont regroupés certains de ses articles, et enfin en 1923 Drames de cinéma, recueil des scénarios
qu’il a lui-même mis en scène comme on le verra plus loin. Dans toutes ses
critiques éclate sa passion pour le cinéma américain et la jeunesse que
celui-ci insuffle à l’art muet. Delluc a des mots durs pour les Français à qui
il reproche leur mauvais goût, leurs conventions vieillottes encore marquées
par le théâtre. Même Feuillade le déçoit ; il considère qu’il ne fait rien
d’intéressant depuis 1914. Max Linder, lui, est salué au contraire par Delluc
comme « le grand homme du cinéma français. Je l’admire. C’est lui et même
lui seul qui a approché avant les autres la simplicité nécessaire au ciné. Dans
l’exécution de ses films, il a approuvé une intelligence étonnante que le
présent justifie. Le mouvement des scènes, la schématisation des effets et des
idées et surtout la forme de ses scénarios – la plupart sont d’une drôlerie
certaine et parfois d’un vif esprit – ont annoncé depuis beaucoup d’années un
type exact de comédie-bouffe cinématographique qui semble encore d’avant-garde
puisqu’on n’a même pas su l’imiter et encore moins le perfectionner. Max Linder
est allé jusqu’à mettre au point ses acteurs. C’est phénoménal. »
En 1918 Louis
Delluc repère les novateurs : Jacques de Baroncelli, Germaine Dulac, Abel
Gance, Marcel L’Herbier, Jean Epstein, André Antoine, artisans d’un cinéma en
devenir, mais il se montre parfois bienveillant là où l’on ne l’attend pas, par
exemple lorsqu’il voit en avril 1919 La
Sultane de l’amour : « Il y a un cabaret turc qui n’est pas mal.
Je crois que traité à la lumière artificielle il eût pris plus de vigueur car
le décor est excellent et les groupements très nets. Certains mendiants sont
remarquables. Pedrelli se bat bien, mais je le préfère dans ses palais et ses
robes et ses rêveries de bord de mer. Il plonge avec une espèce d’art. »
Delluc
semble s’écarter du champ de la critique, mais la liberté dont il dispose lui
permet de s’épancher à profusion, sur des longueurs impensables dans la presse
d’aujourd’hui. Après chaque projection ce méridional disert se plait à jouer
avec les mots. Rien ne lui a échappé. Il a l’acuité visuelle du lynx et la
faconde de Cyrano, mais son agilité verbale, loin de s’exercer à vide, reste au
service d’une pensée maîtrisée. Ce faisant, Louis Delluc établit, dans l’esprit
du spectateur qui le lit, quelques évidences fondamentales qui constituent son
credo.
« Le mouvement de la
vie et, s’il se peut, de la vie intérieure, voilà le but d’un art véritable et
prenant. Ne cherchez pas à faire grand. Ne veuillez pas faire pleurer ou
seulement pleurer vous-même devant l’écran. Écoutez votre sincérité. Elle parle
mieux que vous. Mais il faut reconnaître qu’elle ne parle qu’à ses
heures. » Le cinéma selon Delluc doit avoir une ‘‘force physique’’ à
laquelle concourt la vérité de l’image. L’art muet, comme la musique, a besoin
d’un compositeur qui donne au film
son mouvement, son rythme. « Le cinéma est éminemment musical » Mais
Louis Delluc se garde bien de donner des conseils précis. Le langage, la
grammaire du cinéma, à chacun de les découvrir.
« La
technique, rien de plus facile à posséder », écrit-il en 1918. Une suggestion
tout de même : « Les grands metteurs en scène se sont mis à tourner
constamment pendant le travail. Je pense même qu’il conviendrait de disposer
deux ou trois appareils et opérateurs, suivant la même scène avec des champs
différents et tournant sans arrêt. On trouverait dans le résultat de ce
multiple travail des notes extraordinaires. »
Mais rien sur le découpage du scénario et les mouvements d’appareil. Delluc se
borne à parler de photogénie, en donnant à ce terme un sens très large :
« Disons seulement que la photogénie est la science des plans lumineux
pour l’œil enregistreur du cinéma. Un être ou une chose sont plus ou moins
destinés à recevoir la lumière, à lui opposer une réaction intéressante : c’est
alors qu’on dit qu’ils sont ou ne sont pas photogéniques. Mais le secret de
l’art muet consiste justement à les rendre photogéniques, à nuancer, à
développer, à mesurer leurs tonalités. C’est une entreprise – ou un art si
j’ose m’exprimer ainsi – aussi complexe que la composition musicale, »
note-t-il en 1920.
La technique, si
elle existe, Louis Delluc la garde pour lui et ce n’est pas à ce niveau qu’il
distribue les bons points et les mauvais ; il apprécie le résultat dans sa
globalité. « La vérité lyrique de votre œuvre, (il s’adresse à Ince en
1918) avec ses visages, ses bêtes, sa matière inerte, son âme lumineuse et
clairvoyante, ne s’analysent pas. On ne peut les critiquer, je pense, qu’en les
égalant ou en les dépassant. Plus tard, on essaiera… » Delluc lui-même va
montrer de quoi il est capable, en prenant le risque de s’exposer aux
critiques. Il est maintenant la cible de son propre regard.
En
rédigeant plus de scénarios qu’il n’aura le temps d’en tourner, il garde
présente à l’esprit cette conviction que « les maîtres de l’écran sont ceux
qui parlent au grand public » et non des esthètes confidentiels. Aucun
spectateur ne peut rester indifférent au scénario de La Fête espagnole que Germaine Dulac réalise en 1919, drame
pathétique où deux hommes vont s’entretuer pour les beaux yeux de Soledad (Eve
Francis) qui partira avec un troisième. Ce film qui finalement le déçoit donne
à Louis Delluc le désir de mettre en scène lui-même les suivants : Fumée noire, tentative trop ambitieuse
qu’Eve Francis interprète encore, comme toutes les autres œuvres de son mari.
Dans Le Silence (1920), monologue en images,
un homme attend la femme qu’il aime mais elle arrive trop tard. Fièvre (1921) réunit dans un bar à
matelots de Marseille toutes les composantes d’un fait divers sanglant et c’est
la première réussite absolue de Delluc, qui doit beaucoup à son principal
interprète masculin Van Daele, comparable aux grands premiers rôles américains
de l’époque. Le Chemin d’Ernoa fait
participer à une histoire d’amour le paysage du pays Basque, et on arrive aux
deux œuvres majeures de Louis Delluc : La
Femme de nulle part (1922) où l’héroïne désabusée va à la rencontre de sa
jeunesse en fuite, et L’Inondation
(1923) où la montée des eaux du Rhône exaspère les passions humaines. Là encore
la nature se conjugue à l’action. Ce film vient d’être
présenté lorsque, le 22 mars 1923, Louis
Delluc est emporté par la tuberculose. Il n’aura vécu que 33 ans et la mort
prive le cinéma français d’un de ses créateurs les plus originaux au moment où
il vient enfin d’accorder son œuvre filmique à la très haute exigence de ses
écrits critiques. ■
* Les Écrits
cinématographiques de Louis Delluc ont été édités en 1986 par la
Cinémathèque française. À lire également : Marcel Tariol, Louis Delluc, coll. Cinéma
d’aujourd’hui, Éditions Seghers 1965.
(Article publié dans Cinéscopie n°12 - décembre 2008)